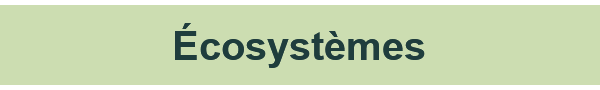Développement durable et acceptable
L’agriculture française va devoir urgemment choisir entre un développement durable et acceptable mais faible ou fort.
Notre agriculture est en effet face à un défi qui en réalité s’avère être un choix incontournable.
Tout simplement.
La durabilité recouvre en effet une notion de durée mais aussi une notion de soutenabilité.
Il faut donc choisir entre dégrader l’environnement pour un maximum de bénéfices ou ne faire que des dégradations acceptables à l’environnement.
Ce choix est d’ailleurs intimement lié à l’histoire de l’agriculture en France par exemple.
Mais aussi au développement industriel en général dans le monde et à la production de Co2.
Le modèle français ne fut pas le seul car tous les pays durent faire le choix de la rentabilité pour nourrir leurs populations.
La limite actuelle du modèle agricole mondial résulte de sa mécanisation qui a introduit les gênes de son industrialisation.
Par contre les descendants des chasseurs cueilleurs que nous sommes ont dépassé les limites acceptables par la planète de sa dégradation.
Que la durabilité soit faible ou forte, le capital naturel de notre planète est au cœur des enjeux autrement dit la survie de notre biosphère.
Durabilité faible
L’agriculture, victime de son système, n’est pas la seule en cause car tous les modèles économiques construits par l’homme se fondent sur une durabilité faible que le développement soit durable et acceptable.
Il faut aussi prendre en compte dans le terme de durabilité, la notion de pérennité.
D’autre part le capital naturel n’est pas seul en lice car il se trouve en concurrence avec d’autres formes du capital.
En effet, coexistent avec lui le capital humain, le capital social et le capital artificiel.
Cet ensemble forme ainsi le capital de l’humanité.
Pour atteindre une durabilité faible, les capitaux doivent être substituables.
Ainsi, dans le cas d’une durabilité faible on accepte que l’humanité dégrade le capital naturel (environnement) dès lors qu’elle transmet davantage de capital artificiel (infrastructures, machines,.. ) à ses générations futures.
Capital et planète
Généralement, on retient quatre capitaux différents dans la somme du capital de l’humanité.
Tout le problème est bien là au regard de ce que représentent ces capitaux :
capital naturel :
- atmosphère (climat)
- biosphère (sols, forêts, rivières et océans, terres fertiles, biodiversité, faune et flore)
- cryosphère (glaciers et banquise)
- lithosphère (minerais et fossiles avec charbon, gaz et pétrole).
le capital humain :
- Humains, alimentation, éducation, santé, sécurité,..
capital social :
- cultures,
- habitudes sociales
- lois et droit
- systèmes de gouvernance
- vie collective
capital artificiel :
- création humaine de bâtiments, d’infrastructures, de machines, de produits, de technologies, d’usines, de villes
Mais un nouvel ordre des choses apparaît au regard des prises de conscience actuelles et des dangers du réchauffement climatique.
Aussi l’ordre des capitaux doit être révisé avec une nouvelle vision planétaire ainsi que ses limites :
le capital des espèces :
- Humains, Faune et Flore
capital social :
le capital structurel :
- organisations et développements des différentes espèces
capital planétaire :
- biosphère
- atmosphère
- cryosphère
- lithosphère
En suivant cette répartition différente on aborde ainsi l’équilibre de la biocénose de la planète qu’il faut préserver.
Mais également la nécessité absolu de préserver le capital global planétaire.
Durabilité forte
Avec l’approche de la durabilité forte, la préservation du capital naturel de notre planète devient la priorité.
Dans les faits, notre consommation d’une partie des des ressources naturelles renouvelables doit correspondre à la capacité de ces ressources à pouvoir se reconstituer.
Ce qui n’est absolument pas le cas du pétrole actuellement par exemple.
A l’inverse, cela devrait être le cas avec la ressource halieutique gravement détruite par la pêche industrielle qui fait disparaître certaines espèces de poissons.
La perte de la biodiversité est d’ailleurs l’antithèse de la durabilité forte.
Développement durable
La sagesse du développement durable arrive finalement très tardivement dans notre prise de conscience actuelle.
Son concept directeur résulte de la Commission Brundtland (1987) : le développement durable permet de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Il ne s’agit pas d’une règle mathématique mais d’un concept régulateur.
Aujourd’hui il se traduit par le respect de principes éthiques (équité, RSE et solidarité) et du principe économique de précaution (vivre avec les intérêts et non avec le capital).
Avec ce concept, le capital naturel n’est pas substituable par un autre et il faut donc préserver les écosystèmes en l’état.
C’est notamment la cas avec la forêt par exemple qui est un outil important de la régulation du carbone tout comme les océans.
A l’inverse, et en dehors de tout scénario catastrophe, sans biosphère intacte il ne peut y avoir de vie social durable et encore moins de développement économique durable ou non.
Les paramètres que sont la surexploitation des ressources naturelles et le changement climatique sont ainsi à la fois causes et conséquences de l’absence de durabilité depuis la période industrielle.
De fait, la soutenabilité économique, et donc son développement, se heurte aux limites de l’environnement qu’elle détruit tandis que la planète voit ses limites être dépassées.
Plus les ressources naturelles s’épuisent et que les ressources artificielles croissent plus la population humaine augmente tandis que d’autres espèces disparaissent.
Les pressions sur la planète sont ainsi de plus en plus fortes.
Jusqu’à présent les progrès techniques permettaient l’accroissement des rendements agricoles et retardaient ainsi la limite de la croissance démographique.
Il semble par contre aujourd’hui qu’en l’absence de durabilité nous ayons atteint et dépassé la limite de la modification de l’environnement.
Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992 et son concept de développement durable rien n’a permis d’inverser un quelconque processus pour imposer ce qui est acceptable.
Article : P. du Chélas
Développement durable et principes
Biocénose et biotope
Pollutions de la biosphère
Gestion durable ou communautaire des forêts
Les 9 limites planétaires de Johan Rockström
Céréales et Sécurité Alimentaire
Ressources en eau de notre planète bleue
Pêche industrielle et lobbying du thon
Sécurité énergétique et insécurité économique
Responsabilité Sociétale des Entreprises – RSE
Conférence de Johannesburg de 2002 sur le développement durable
Convention d’Aarhus / UICN / AI Act

Crédits Photos : Pixabay.com
Site web de partage d’images diffusées en licence libre